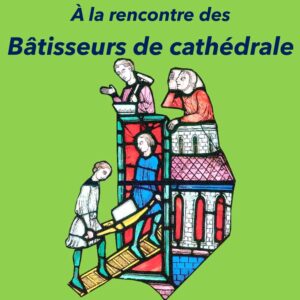« Quelques années avant le milieu du XIIe s. la dévotion à Notre-Dame de Chartres prend une forme nouvelle. À l’occasion des grands travaux qui étaient alors en cours à la cathédrale, les pèlerins s’attelèrent aux chariots qui amenaient à pied d’œuvre, quelquefois de fort loin, les matériaux ainsi que les provisions destinées au ravitaillement des ouvriers. Nul n’était admis à ces pieuses corvées, s’il n’avait fait pénitence de ses fautes et réparé le tort qu’il avait pu faire à son prochain ».
L’historien Yves Delaporte s’en tient aux faits tandis qu’on a beaucoup (trop) écrit sur le sujet, depuis plus de 150 ans. D’abord pour présenter la construction des cathédrales comme un effort émanant de toute la population, où chacun contribue – à défaut d’argent, par ses moyens physiques.
C’est évidemment faux : le chantier est entièrement l’affaire de professionnels salariés. Ensuite, pour nier la réalité décrite par les sources contemporaines, ce qui est tout aussi abusif. Au-delà du motif littéraire de l’élan populaire, il y aurait bien eu certaines pratiques étonnantes de confréries – qui seraient directement liées à l’enthousiasme suscité par la construction. Mieux que les allusions et dénégations, mieux que les citations tronquées : voici les trois textes – traduits.
L’archevêque de Rouen, Hugues, écrit à Théodoric, évêque d’Amiens, en 1145 :
« Les œuvres de Dieu sont grandes et toujours proportionnées à ses volontés ! C’est à Chartres que des hommes commencèrent à traîner des chariots et des voitures pour élever une église, et que leur humilité fit jaillir des miracles. Le bruit de ces merveilles s’est répandu de toutes parts, et enfin a réveillé notre Normandie de son engourdissement. Nos fidèles, après avoir demandé notre bénédiction, ont voulu se rendre en ces lieux [Chartres] et accomplir leurs vœux ; puis sont revenus, à travers notre diocèse et dans le même ordre, retrouver l’église de notre évêché, leur mère ; bien résolus à n’admettre dans leur société personne qui n’eut auparavant confessé ses péchés et fait pénitence, qui n’eut déposé toute haine et tout mauvais vouloir, qui ne fut rentré en paix et en sincère concorde avec ses ennemis. Avec de semblables résolution, l’un d’eux est nommé chef ; et, sous son commandement, tous humblement et en silence s’attèlent à des chariots, offrent des aumônes, s’imposent des privations et versent des larmes… Ainsi disposés, ils sont témoins en tous temps, mais surtout dans nos églises, de nombreux miracles opérés sur les malades qu’ils conduisent avec eux, et ils ramènent guéris ceux qu’ils avaient amenés infirmes ».
Robert du Mont, autre contemporain, dans ses ‘Chroniques’ :
« Ce fut à Chartres que l’on vit pour la première fois des hommes traîner, à force de bras, des chariots chargés de pierres, de bois, de vivres et de toutes les provisions nécessaires aux travaux de l’église dont on élevait les tours. Qui n’a pas vu ces merveilles n’en verra jamais de semblables, non seulement ici, mais dans la Normandie, dans toute la France et dans beaucoup d’autres pays. Partout l’humilité et la douleur, partout le repentir de ses fautes et l’oubli des injures, partout les gémissements et les larmes. On peut voir des hommes, des femmes, même, se traîner sur les genoux à travers les marais fangeux et se frapper durement la poitrine en demandant grâce au ciel, tout cela en présence de nombreux miracles qui suscitent des chants et des cris de joie ».
Dans son « Histoire des Miracles qui se sont faits par l’entremise de la Sainte Vierge en 1140 » l’abbé Haymon, de Saint-Pierre-sur-Dives, témoin des faits, les raconte ainsi, avec une volonté de réalisme – quasi cinématographique :
« Qui n’a jamais vu des princes, des seigneurs puissants de ce siècle, des hommes d’armes et des femmes délicates, plier leur cou sous le joug auquel ils se laissent attacher comme des bêtes de somme, pour charrier de lourds fardeaux ? On les rencontre par milliers traînant parfois une seule machine, tellement elle est pesante, et transportant à une grande distance du froment, du vin, de l’huile, de la chaux, des pierres et autres matériaux pour les ouvriers. Rien ne les arrête ni monts, ni vaux, ni même rivières ; ils les traversent comme autrefois le peuple de Dieu. Mais la merveille est que ces troupes innombrables marchent sans désordre et sans bruit… leurs voix ne se font entendre qu’au signal donné : alors ils chantent des cantiques ou implorent Marie pour leurs péchés… Arrivés à leurs destinations, les confrères environnent l’église ; ils se tiennent autour de leurs chars comme des soldats dans leur camp. À la nuit tombante, on allume des cierges, on entonne la prière, on porte l’offrande sur les reliques sacrées ; puis les prêtres, les clercs, et le peuple fidèle s’en retournent avec grande édification, chacun dans son foyer, marchant avec ordre, en psalmodiant et priant pour les malades et les affligés ».
Ce texte fait partie d’une lettre écrite, en 1145, aux religieux de Tuttebery (Ang.).
Cet été, invitez vos enfants à découvrir l’univers fascinant des bâtisseurs de cathédrales ! Plongez dans l’histoire et laissez-vous captiver par les récits des artisans médiévaux lors de notre visite thématique spéciale enfants de 7 à 12 ans : « À la rencontre des bâtisseurs de cathédrale ».
En savoir plus